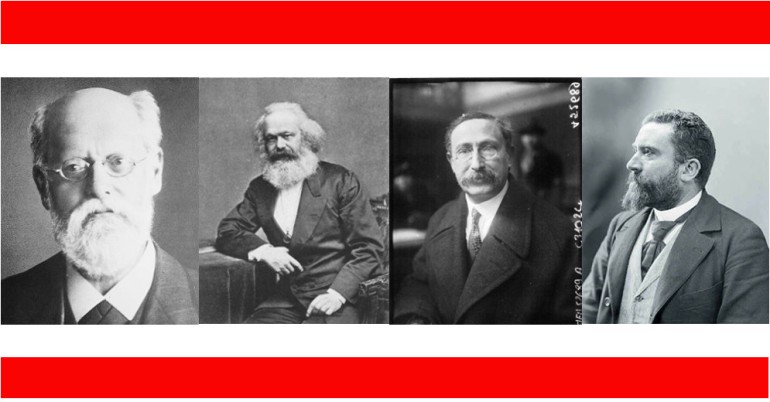DV. On emploie successivement et parfois indifféremment les termes de socialisme, de social-démocratie, de social-libéralisme. Comment les définir ?
Gérard Grunberg : Les termes ont évolué au cours de l’histoire et ils n’ont pas le même sens d’un pays européen à l’autre. C’est en Allemagne qu’a été créée la social-démocratie qui a donné naissance à la IIème Internationale. Le SPD était un parti marxiste qui a réussi, comme d’autres partis dans l’Europe du Nord, en fondant une « contre-société ». Celle-ci prenait en charge les travailleurs « du berceau au cercueil », disait-on, parce que, au début du XXème siècle, les travailleurs étaient en quelque sorte les parias de la société officielle. D’où la construction de cette « contre-société ».
Ce n’était le cas en France où, dès 1905 et la Charte d’Amiens, il y a une coupure entre les partis de gauche et les syndicats. Le lien organique entre la politique et la revendication syndicale est rompu. A cela s’ajoute que, par rapport à l’Allemagne par exemple, l’industrialisation est plus tardive dans les pays d’Europe du sud. Ainsi les partis communistes qui apparaissent après la Révolution russe, deviennent les vrais partis ouvriers, tandis que du côté des syndicats se développe le syndicalisme révolutionnaire. Par opposition à l’Europe du nord, où les syndicats très liés aux partis politiques gèrent d’abord la « contre-société » avant d’être associés à la gestion de la société globale. Dès avant la IIème guerre mondiale, on assiste par exemple à une parlementarisation de la social-démocratie.
En Angleterre on a le phénomène inverse mais qui aboutit au même résultat : avec le travaillisme, ce sont les syndicats qui créent le parti pour avoir une représentation parlementaire et le groupe parlementaire finit par diriger le parti.
Les partis social-démocrates, y compris en Europe du nord, n’en restent pas moins marxistes.
Les partis scandinaves abandonnent le marxisme dans les années 1930 et participent au pouvoir. En Allemagne, ce sera un peu plus tard, à cause du nazisme. Il faut attendre 1959 pour que le SPD, au congrès de Bad-Godesberg, renonce au marxisme et se rallie à l’économie sociale de marché et à l’intégration européenne.
En France, la rupture est plus tardive encore, si toutefois elle a eu lieu.
En effet, c’est une spécificité française. En 1971, le Parti socialiste se reconstitue sur une ligne anti-réformiste de rupture avec le capitalisme. Le terme social-démocrate reste une injure. Les social-démocrates sont considérés comme des traitres à la cause du socialisme. Dans le PS français on reste anti-social-démocrate par idéologie.
La SFIO, avec laquelle le PS de François Mitterrand prétendait rompre, avait pourtant été associée au pouvoir sous la IVème République, pour ne pas parler d’autres « compromissions ».
Le PS se recrée en 1971 contre le « molletisme », du nom de Guy Mollet, le secrétaire général de la SFIO. Le « molletisme » incarne bien ce socialisme français qui n’était ni réformiste ni vraiment révolutionnaire. La SFIO se revendiquait du marxisme mais en fait était parlementariste, et ce depuis Jaurès et Blum, mais elle ne l’admettait pas dans sa doctrine. Sa politique était fondée sur le double langage : on participe au pouvoir avec tous les compromis voire les reniements que cela suppose, mais ce n’est pas grave parce qu’un jour on fera la révolution.
Et cette spécificité française a survécu à la SFIO.
Dans une grande mesure, oui. Or pendant ce temps, au début des années 1980, on assiste à un tournant dans les pays du sud qui comme l’Espagne et le Portugal sortent de régimes autoritaires. Les partis socialistes se reconstituent sur une base réformiste et, en plus, autour de personnalités très fortes, comme Felipe Gonzalez en Espagne ou Andreas Papandréou en Grèce. Et dès le début ce sont des partis de gouvernement.
Le PS, lui, reste dans l’ambiguïté. Il est un parti radical dans ses textes mais Mitterrand l’a amené au pouvoir et l’a compromis avec le libéralisme.
Les tentatives de « rénovation » idéologique n’ont pourtant pas manqué.
En 1991, Pierre Mauroy tente une révision idéologique au congrès de l’Arche. On pouvait se dire social-démocrate et on adhérait à l’économie de marché. Dans la nouvelle déclaration de principes de 2008, la quatrième en un siècle, on retrouve les mêmes idées.
Pourquoi le PS donne-t-il l’impression d’être toujours mal à l’aise avec ces principes ?
Parce qu’il est toujours à la recherche d’épouvantails pour se rassembler et pour se distinguer. Il y a eu « la deuxième gauche » : c’est un épouvantail qui a été utilisé pour discréditer une partie des socialistes et se dire révolutionnaire. Il y a eu le « blairisme » qui était une révision radicale du socialisme et même de la social-démocratie qui ne serait pas adaptée au monde d’aujourd’hui. Le « blairisme » posait de vraies questions : comment un pays se défend-il dans la mondialisation ? Avec un marché du travail fluide. L’Etat n’a pas à s’occuper de l’économie. Les intérêts entre les patrons et les salariés ne sont plus divergents. L’intérêt de tous est d’être bien insérés dans l’économie mondiale. Gerhard Schröder et même les communistes italiens ont été intéressés par cette « troisième voie » prônée par Tony Blair.
Mais l’ensemble de la IIème Internationale l’a refusée. La majorité s’est prononcée contre Blair et a refusé le libéralisme. C’est Lionel Jospin qui a le mieux résumé cette position : nous sommes pour l’économie de marché mais pas pour la société de marché. L’Etat – et donc la politique – restent au commandement de l’économie et de la société.
La polémique autour de la social-démocratie et du social-libéralisme a-t-elle un sens ?
Le social-libéralisme sert à disqualifier l’autre, comme la social-démocratie était utilisée pour dénoncer les « traitres » dans les années 1970. Le problème que le quinquennat de Hollande met en évidence, c’est que les socialistes n’arrivent pas à tenir les deux bouts d’un parti au pouvoir qui se veut radical. Les contraintes internes et externes ont atteint un tel degré de contradiction que c’est devenu intenable.
Le PS n’est pas le seul parti de gauche en Europe dans cette situation.
On assiste en effet à une crise structurelle de la social-démocratie européenne. Il n’y a pas un seul parti social-démocrate en Europe qui ne gouverne avec la droite (sauf en France justement et peut-être demain en Grande-Bretagne à cause du mode de scrutin). Le clivage gauche-droite n’est plus structurant pour les idées politiques. Je prends très au sérieux le nouveau clivage européen-souverainiste. Le mouvement de rejet des musulmans en Europe est plus puissant qu’on ne le croit dans les classes populaires. L’ennemi n’est plus le patron mais l’étranger.